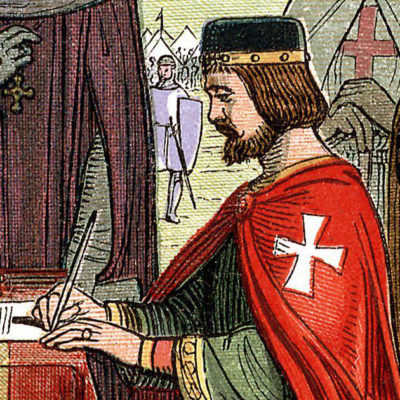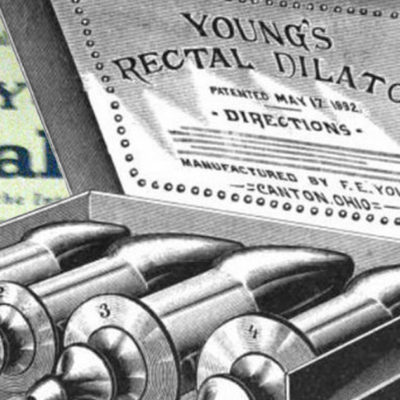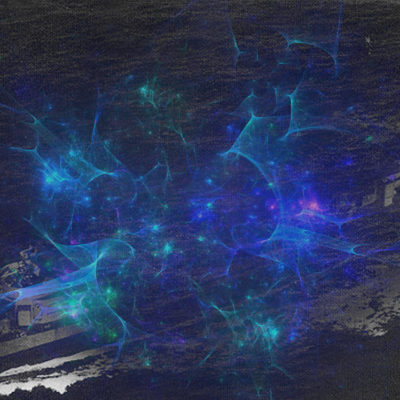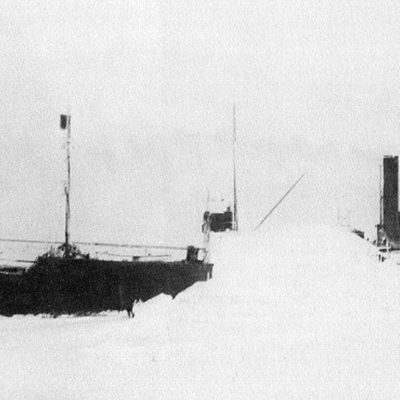Pratiques sexuelles, tabous et condamnations au Moyen Age
Magie amoureuse
Angoissées à l’idée de se voir abandonnées par leur mari, les femmes leur faisaient boire des philtres magiques ou recouraient à des pratiques sexuelles prohibées par l’Église. Il est attesté vers l’an mil que certaines avalaient le sperme de leur conjoint, leur servaient à manger des poissons qu’elles avaient introduits encore vivants dans leur propre intimité, jusqu’à leurs derniers frétillements, ou leur donnaient à manger du pain pétri sur leur derrière. D’autres préféraient rendre leur mari impuissant en leur faisant consommer du pain résultant du processus suivant : une fois entièrement nues, elles s’enduisaient le corps de miel, se roulaient dans un drap couvert de grains de blé, recueillaient les grains restés collés sur elles puis les écrasaient en faisant tourner la meule dans le sens contraire du soleil. D’autres encore mêlaient aux aliments le sang de leurs règles. Vers 1300, la châtelaine de Montaillou, Béatrice de Planissolles, interrogée par les inquisiteurs à propos du linge souillé de sang menstruel retrouvé chez elle, répondit qu’il s’agissait de celui des premières règles de sa fille Philippa. Sur les conseils d’une juive, elle l’avait conservé pour ensorceler son gendre en lui faisant ingurgiter, avec succès, une partie de ce philtre magique; elle conservait aussi les cordons ombilicaux de ses petits-fils en guise de talisman pour gagner ses procès contre l’Inquisition. À la fin du XIVe siècle, à l’occasion d’un procès au Châtelet, Marion la Droiturière apprit d’une prostituée que, pour provoquer le mal d’amour chez l’être aimé, il convenait de mélanger à son vin un peu de «ses fleurs rouges»... Les matières organiques de ce genre étaient, croyait-on, capables de susciter la fécondité, donc l’amour et la continuité du lignage, ou perpétuer la chance. Ainsi était-il coutumier de conserver aussi les poils et les ongles d’un mort pour fixer la fortune dans la maison familiale. Il n’y a pas si longtemps que les jeunes Languedociennes mélangeaient encore une goutte de leur sang menstruel à une boisson ou introduisaient une raclure de leur ongle dans un gâteau pour se faire aimer d’un garçon. Et lorsqu’une femme voyait son amant la quitter pour rejoindre son épouse, elle tâchait de le rendre impuissant par toutes sortes de procédés.
Quant aux nobles, ils comptaient sur des amulettes pour, disait- on, «faire leur volonté de toutes femmes». Elles consistaient généralement en un petit sachet de poudre à base d’ossements de pendu porté autour du cou, ou encore en une bague enfilée à la main gauche, après être restée quelques heures dans la bouche d’un cadavre de supplicié.
Tarif de pénitences pour tabous violés
L’Église condamnait à des pénitences «tarifées» ce genre de pratiques magiques ou autres péchés sexuels dans des pénitentiels, manuels destinés aux confesseurs, tel celui de Burchard, de Worms (début XIe siècle). Pour avoir avalé du sperme, la pécheresse était condamnée à sept ans de régime au pain et à l’eau. Si elle avait mêlé à la nourriture ou à la boisson de son mari ou de son amant ne fût-ce qu’un peu de sang menstruel, cinq ans de jeûne. Si un célibataire avait forniqué avec l’épouse d’autrui, il méritait quatre jours au pain et à l’eau et sept ans de pénitence. La même peine était réservée à celui qui avait commis le même péché avec une moniale, «c’est-à- dire avec l’épouse du Christ », plus condamné au pain et à l’eau chaque vendredi de sa vie. Un prêtre qui donnait un baiser à une femme par désir charnel devait faire pénitence durant vingt jours au pain et à l’eau, quarante s’il en découlait de la semence... La peine fut plus sévère pour Benoît de Sceppere, qui, en 1474, fut condamné par l’officialité de Tournai à jeûner toute sa vie. Il faut dire qu’il avait « connu charnellement » deux sœurs à la suite, puis la fille de l’une d’entre elles...
Homosexualité assimilée à la bestialité
L’étude de l’homosexualité au Moyen Âge est difficile: les documents sont lacunaires et aucun mot précis ne la désigne. On parlait d’homme délicat, efféminé; le terme mollesse (mollities) indiquait le penchant d’un individu pour les hommes. Le substantif sodomie recouvrait alors toutes sortes de pratiques qui n’étaient pas exclusivement homosexuelles et n’avaient pas pour finalité la procréation. Depuis le début du christianisme, l’Église les condamna catégoriquement, y compris celles entre femmes, mais ces dernières firent l’objet d’une moindre attention.
On trouve dans le pénitentiel de Burchard de Worms :
« 120. As-tu forniqué comme le font les sodomites en mettant ta verge dans le postérieur d’un homme? Si tu es marié et si tu l’as fait une ou deux fois: 10 ans de pénitence aux jours officiels, dont l’un au pain et à l’eau. Si c’est une habitude : 12 ans. Si c’est avec ton frère de chair : 15 ans. »
L’échec des croisés en Orient fut attribué aux mœurs débauchées d’un certain nombre d’entre eux, en particulier la sodomie, favorisée paraît-il par le climat chaud. À partir de la fin du XIIe siècle, les musulmans furent perçus en Occident comme des «sodomistes» faisant indistinctement l’amour aux femmes et aux hommes, allant jusqu’à sodomiser des évêques et à contaminer les chrétiens par leurs pratiques infâmes.
Entre 1150 et 1250, la pensée et la morale se firent plus intolérantes envers tout ce que l’on considérait « contre nature ». Ainsi, de péché abominable, l’homosexualité devint un crime, assimilé à l’hérésie, donc punissable par le feu. Thomas d’Aquin, dans son exposé sur les plaisirs non naturels, la considérait tout au moins comme une dégradation de l’âme, au même titre que la bestialité et l’anthropophagie, contraires à la nature humaine.
À la fin du XIIe siècle, les autorités civiles légiférèrent, prévoyant des peines qui allaient de l’amende au bûcher, en passant par la confiscation des biens, la flagellation ou la mutilation, selon la gravité des circonstances. Les peines les plus cruelles étaient réservées aux cas d’homosexualité accompagnés de viol sur enfant. Mais il semble que les condamnations furent peu nombreuses avant le XIVe siècle. La répression devint ensuite plus systématique, en raison d’un contrôle plus rigoureux. Selon Jacques Despars, médecin du XVe siècle, « il faut amener les homosexuels à la tristesse par l’invective et le blâme, puis les torturer en les affamant, les fatiguer en les privant de sommeil, les jeter en prison, enfin les fouetter jusqu’au sang ». Au début du même siècle, Jean Gerson prétendait que l’homosexualité engendrait «famines, guerres, mortalités et perditions de rois, royaumes, et autres pestilences selon l’Écriture». À Florence, les gens furent invités à glisser des lettres de dénonciation dans des tambours (troncs). En soixante-dix ans, dix mille personnes, dont Léonard de Vinci, en furent les victimes. En France, encore au XVIIIe siècle, en dépit des lumières, nombre de coupables de sodomie furent brûlés.
Quant à la prostitution masculine, sur laquelle on ne sait pas grand-chose, elle était tout autant proscrite. Le phénomène était surtout réel en Italie et dans les grands ports de la Méditerranée. Tant les femmes travesties en hommes que les hommes travestis en femmes, pour racoler d’autres hommes, étaient dans le collimateur des cours de justice. En 1372, on jugea à Reims un certain Raymond qui faisait la barbacane (le trottoir), fardé et vêtu en femme. Il avait été dénoncé par un noble, trompé par l’apparence. Selon certains, des bordels homosexuels, avec des prostitués pour tous les goûts, auraient existé dans les milieux estudiantins en Ile-de-France au XIIe siècle, mais les preuves manquent. Quoi qu’il en soit, il serait imprudent d’affirmer que l’homosexualité était peu répandue au Moyen Âge.
L’Église assimilait la sodomie à la bestialité. À ce propos, le pénitentiel de Burchard précise :
«126. As-tu commis la sodomie ou la bestialité, avec des hommes ou des animaux, à savoir avec une vache, une ânesse ou avec tout autre animal?» Suit une liste de pénitences en fonction de la fréquence et de la gravité des circonstances.
Du XIIIe à la fin du XVIIIe siècle, les coupables de ces « crimes contre nature», dont la gravité était déjà assimilée à l’hérésie sous saint Louis, étaient en principe envoyés au bûcher, mais dans une proportion impossible à préciser. La bestialité était en fait considérée encore plus grave que la sodomie et l’animal montait avec l’homme ou la femme coupable sur le bûcher parce qu’il avait été l’instrument de «la plus abominable des abominations »87.
Cas de pédophilie
Vers 1300, dans des villes comme Toulouse et dans sa région, les rares écoliers faisaient lit commun avec leurs condisciples et leurs maîtres, destinés le plus souvent à la carrière ecclésiastique. Arnaud de Verniolles, originaire de Pamiers, lui-même initié dans son enfance à l’homosexualité par un camarade plus âgé, condisciple et candidat à la prêtrise, témoigne :
« J’avais alors dix à douze ans. C’était il y a vingt ans environ. Mon père m’avait placé pour apprendre la grammaire chez Maître Pons de Massabucu. Je faisais chambre commune avec ce maître Pons et ses autres élèves, Pierre de l’Isle (de Montaigu), Bernard Balessa (de Pamiers) et Arnaud Auriol, le fils du chevalier Pierre Auriol. Dans la chambre commune du maître et des élèves, j’ai couché pendant bien six semaines dans le même lit qu’Arnaud Auriol [...] À la quatrième ou cinquième nuit que nous passions ensemble, comme Arnaud pensait que j’étais en plein sommeil, il a commencé à m’embrasser et à se mettre entre mes cuisses et à s’y mouvoir comme si j’étais une femme. Et il a continué à pécher ainsi chaque nuit. Je n’étais encore qu’un enfant, cela me déplaisait. Mais, pris de honte, je n’ai osé révéler ce péché à quiconque... »
Néanmoins, la petite victime deviendra elle-même à l’âge adulte pédophile, culbutant les jeunes garçons tantôt sur un tas de fumier, tantôt dans un cabanon isolé dans une vigne. L’un d’eux atteste :
« Arnaud me menaça d’un couteau, me tordit le bras, me traîna de force malgré mes ruades, me jeta à terre, en m’embrassant et en répandant sa semence entre mes jambes. »
Les étuves pour des moments chauds...
Les croisés rapportèrent de Terre Sainte la pratique des étuves. Les riches possédaient des étuves privées, le commun se satisfaisait des établissements publics dans les villes.
En rue, dès l’aube, des crieurs avertissaient le client quand les bains étaient chauds. En 1297, on comptait 26 étuves à Paris, pour une population de 150000 habitants. Au XIIIe siècle, la moyenne dans les villes grimpa à environ une étuve pour 10 000 âmes. Aux deux siècles suivants, on en trouvait dans les
moindres bourgades de 1000 ou 1500 habitants. Une rivière toute proche ou un puits assurait le ravitaillement en eau. Les locaux comportaient: une chaufferie, avec une chaudière et un fourneau pour chauffer l’eau, diffusée et évacuée par des canalisations, une salle de bains chauds avec des cuves en bois ou en métal d’environ 1 mètre de long, 70 centimètres de large et 80 de haut, parfois une chambre tiède et un sauna, ainsi que des aires de repos. Lieux d’hygiène, les étuves étaient aussi des centres de loisirs. Un roman du XIIIe siècle raconte que les jeunes gens des deux sexes venaient y festoyer, chanter, danser au son des tambours, jouer aux dés ou aux échecs, se promener dans les prés et jardins avant de se baigner ensemble, avec des chapeaux de fleurs sur la tête.
Des miniatures montrent des baignoires mixtes avec des serviettes déposées sur les rebords des cuves et dans lesquelles un homme et une femme se tenaient vis-à-vis, à chacune des extrémités. Ensemble, ils se baignaient, suaient, se rapprochaient pour s’enlacer. La nudité était de règle, sauf pour les servantes, vêtues de légères chemises. Quelquefois, par pudeur, on tirait les rideaux d’un dais (épervier ou ciel) fixé au-dessus de la baignoire ou baigneresse. Les étuviers servaient de quoi boire et se sustenter « sur le pouce », mais parfois aussi des repas fins et bien arrosés ; ils fournissaient du savon liquide, des parfums et des plantes aromatiques infusées dans l’eau; ils lavaient les serviettes outoiles, les bonnets de bain en forme de turban, les draps, les courtepointes et les oreillers des chambres à coucher. Les prix étaient démocratiques: deux deniers pour un bain vapeur, quatre pour un bain tiède, plus un denier pour la serviette, tout au moins pour celui « qui le voudra avoir ». Des réductions étaient accordées à ceux qui partageaient une même baignoire. Les clients assidus pouvaient souscrire à des abonnements. On trouvait des étuves aussi bien dans des quartiers opulents que sordides, en fonction de la qualité de l’établissement. Tout un monde séparait le bon hostel du clapier.
Très tôt, les étuves sont aussi devenues des lieux de débauche. Dès le XIIe siècle, aller s’estuver devint une expression courante à connotation érotique. Un fabliau atteste que l’«on s’y baignait et mangeait nu entre amants, tout en se livrant à des attouchements intimes... au vu et au su des autres couples présents». Des satires et procès désignent les chambres par les termes bordelages, bordeaux, putaceries... Si la nudité totale et la mixité ne choquaient pas ou étaient tolérées, le clergé en vint vite à les dénoncer, car «c’est vile chose et honteuse pour les ordures et pour les périls qui y peuvent advenir ». Dès le XIIIesiècle, et surtout au XVe, les autorités municipales emboîtèrent le pas et se plaignirent de la prolifération des étuves-bordels, en général dans les quartiers de prostitution. Nombre d’ordonnances furent prises pour mettre un terme aux excès, en particulier la séparation des sexes. Mais la fréquence de leur répétition témoigne de leur inefficacité. L’une d’elles prescrivait aux hommes: «Lave-toi dans un bain d’hommes et non dans un bain de femmes, de crainte qu’après t’être déshabillé tu ne sois captivé par une femme ou que tu en captives une. » Et aux femmes : « Ne va pas te laver avec les hommes quand il y a des bains pour femmes, ou, s’il n’y en a pas et que tu as besoin de te laver avec, alors lave-toi avec honte et modestie, car il est nécessaire que tu fuies le spectacle des yeux que présentent les bains.» D’autres règlements, comme à Dijon, défendaient aux deux sexes de se rendre ensemble chez un étuveur et leur attribuaient des jours de la semaine différents. Deux sanctions possibles pour les actes deshonnestes: une amende, ou, humiliation suprême, la confiscation des vêtements... Mais les interdictions étaient aisément contournées. En 1268, Étienne Boileau, prévôt de Paris, rapporte que des hommes restaient toute la nuit sur les lits de bois installés près des cuves, jusqu’au petit jour, et que des dames allaient alors « à chambre aux hommes par ignorance... » En 1441, le synode d’Avignon interdit la fréquentation des étuves du pont aux ecclésiastiques et aux hommes mariés. Est-ce là que «les beaux messieurs et les belles dames dansaient tous en rond » ? Il semble bien qu’ils faisaient «comme ça», répond Jean-Claude Bologne!En tout cas, des témoignages montrent que dans des pièces appropriées, des chambrières ou autres fillettes amoureuses, sous la surveillance de maquerelles, pratiquaient des massages spéciaux ou d’autres services dûment tarifés... Parmi ceux-ci, également, des soins du corps, car les étuves de classe étaient aussi de véritables centres de beauté. Les étuveurs bichonnaient leurs clients, les frictionnaient, les rasaient, leur coupaient les cheveux, leur lavaient la tête, ponçaient la peau des femmes pour la rendre plus blanche, ouvraient les abcès de pus, pansaient les plaies, posaient des ventouses, dix au total et après l’étuvage: quatre dans le dos, deux sur les reins, deux au-dessus des coudes et deux au-dessous des genoux. Les clients raffinés s’en faisaient même poser sur la veine de la fesse pour péter plus clair !
Bordels exutoires bon marché
À la fin du XIIe siècle, l’essor des villes et la masse des célibataires qui y vivaient contraignirent la morale sociale et l’Église à un peu plus de permissivité, du moins pendant un temps. Tout en condamnant la prostitution publique, on entendait en même temps contrôler ce phénomène impossible à éradiquer, pour en exclure les enfants, les épouses et les nonnes, ne tolérer que des prostituées étrangères à la ville, de manière qu’on ne tombe jamais sur un membre de sa famille. Ce fut aussi l’occasion de soutenir les notables, de soustraire les jeunes hommes au plaisir solitaire et de les préparer au mariage et à la normalité. Au XVesiècle, toutes les villes françaises semblent avoir eu leur bordel municipal, souvent construit sur fonds publics, toujours régi ou réglé par le Magistrat urbain et, en principe, réservé aux célibataires. Le prix de la passe avec les filles «publiques» ou « communes » y était fort démocratique : environ un huitième à un dixième du salaire journalier moyen d’un ouvrier. Pas cher...
Viols collectifs à la pelle
80% des viols connus étaient collectifs et 70 à 80% des cas ne parvenaient pas à la justice. Dans la deuxième moitié du XVe siècle, à Dijon ou à Douai, un très grand nombre de jeunes gens avaient, sinon violé une fille, au moins participé à une agression sexuelle collective contre l’une d’entre elles. À Dijon, une vingtaine au moins avait lieu chaque année, presque toujours la nuit. Le scénario était presque toujours le même. Des excités chahutaient sous les fenêtres de la proie qu’ils s’étaient choisie, l’enjoignaient grossièrement à descendre, la traitaient de ribaude. Comme elle ne se montrait pas, ils enfonçaient la porte, allaient l’empoigner, la traînaient de force dans la rue, la battaient et la violaient, chacun à leur tour, parfois durant toute la nuit. Les voisins, alertés par le bruit, se contentaient huit fois sur dix à ne rien perdre du spectacle par une fente de leur volet, sans réagir.
Conséquences imprévisibles de l’ascèse monacale
Surtout à partir du XIVe siècle, la littérature médicale répandit l’idée qu’une ascèse excessive pouvait engendrer des troubles mentaux graves. Cette opinion avait germé depuis la fin du XIe siècle, quand le traité De la mélancolie, adaptation d’une source gréco-arabe par Constantin l’Africain, affirma :
«Les religieux dignes de respect, en jeûnant le jour et en veillant la nuit, souffrent d’une diminution de leur sang qui se trouve transformé en bile jaune, puis, sous l’effet d’une lente humidification, en bile noire qui engendre la maladie mélancolique.» Et plus loin: «Le coït aide à la guérison de la mélancolie. »
De fait, tout au long du Moyen Âge, il est attesté que les moines avaient tendance de souffrir d’acédie, un syndrome d’anxiété et de dépression dont les symptômes étaient la faim et le sommeil subits, des envies de nouveauté, un désir incontrôlable, le manque de concentration dans la lecture et la prière ainsi qu’une grande fatigue. Si on en croit Pierre Damien, pour lutter contre ces deux derniers maux, le moine Rodolphe usait d’un moyen original : se suspendre par les bras à des cordes fixées au plafond de sa cellule et se balancer en récitant des Psaumes.