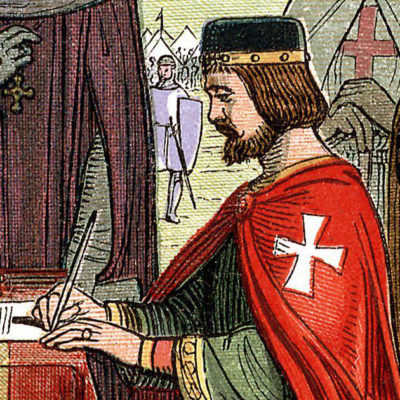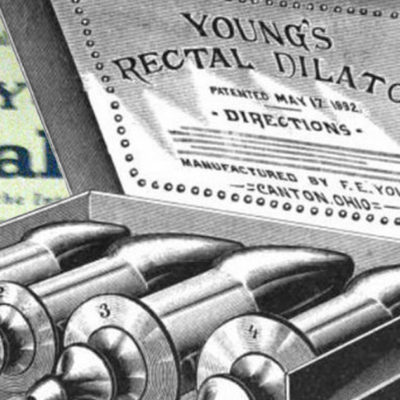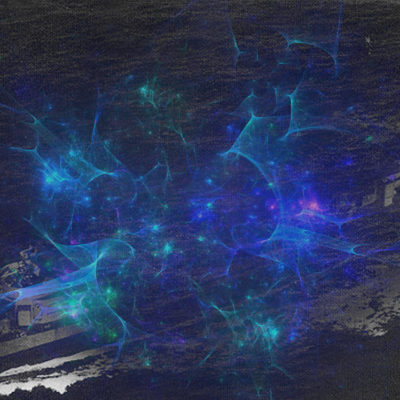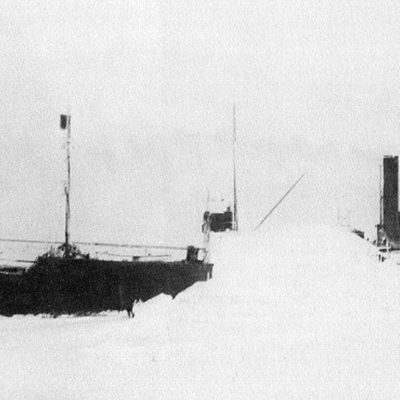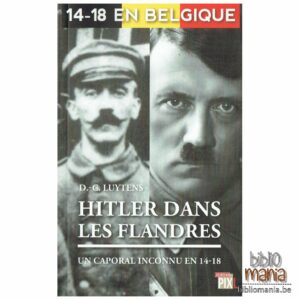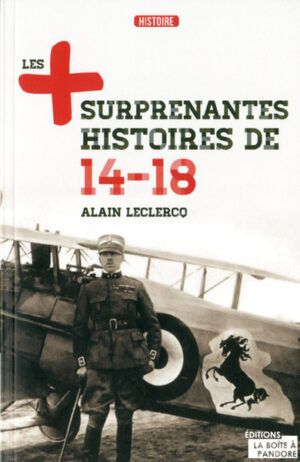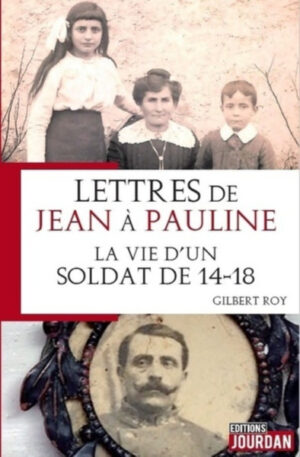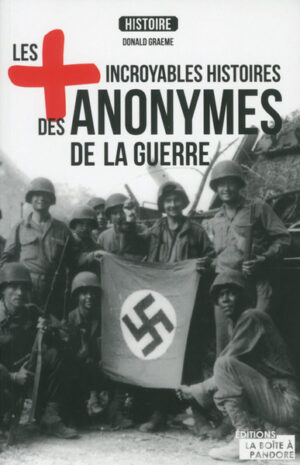Le dernier jour d’un condamné
C’est un lundi de novembre 1918, à Chaumon-Devant-Damvillier, dans la Meuse, que deux soldats s’avancent dans la brume sous l’ordre de leur général. En face d’eux, sur les lignes ennemies, les Allemands les regardent, ahuris : c’est le 11 novembre 1918, et les poilus, dans leurs tranchées, ont déjà eu vent de la victoire imminente. L’un d’entre eux se moque certainement de voir ces deux Américains courir dans leur direction, quand un, plus sérieux, décide de tirer au-dessus de leur tête en signe d’avertissement. Henry Gunther, alors âgé de 23 ans, poursuit son offensive et est abattu de cinq balles dans la poitrine. Il s’écroule et meurt à 10 h 59, en martyr. Trente secondes plus tard, la Première Guerre mondiale se termine, et laisse derrière elle ce soldat connu pour être le dernier mort de ce conflit sanglant, en plus de dix millions d’autres soldats qui ne se relèveront pas, et six millions de mutilés.
Comment expliquer à la famille d’Henry Gunther, qui fête la victoire des Alliés de l’autre côté de l’Atlantique et attendent de voir revenir leur fils, qu’entre 5 h 15, heure de signature du fameux armistice, et 11 h, heure du cessez-le-feu effectif, Henry et des centaines d’autres soldats sont morts alors que tous les généraux que les combats ont épargnés célébraient d’ores et déjà leur victoire —ou admettaient leur défaite. Vers 11 h 30, les soldats racontent même que Français, Anglais, Américains et Allemands se regardent pour la première fois sans arme, et traversent les champs de bataille pour s’échanger des cigarettes, des chocolats ou des souvenirs. Allemands, Français : ils ne sont que des hommes. Premier, dernier, les morts tombés au combat ne sont plus des victoires ou des défaites, mais des pertes.
Pourtant, Henry Gunther devient un symbole. Il n’est pas le soldat inconnu de l’Arc de Triomphe, sur lequel les mères peuvent pleurer en se demandant s’il s’agit de leur fils, il ne fait pas non plus partie des plus braves, des régiments décimés de Verdun ou de la Somme, des déserteurs ou des mutins. Il n’est que le dernier, peut-être le moins chanceux, à périr sous les balles allemandes. Une mort absurde, à la dernière minute, dans une guerre qui l’aura été pendant 4 ans. Le « der des der » du conflit du même nom repose aujourd’hui dans sa ville natale, à Baltimore. Une plaque à son effigie a été inaugurée en septembre 2008 et un livre de Roger Faindt, 10 h 59, puis un film du même nom raconte le destin tristement connu de l’Américain antimilitariste qui a suivi les ordres d’un général jusqu’au-boutiste.
Dans la bibliothèque
Le deuil en symboles
Des symboles, c’est que la France a fait de mieux, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Si d’immenses monuments aux morts sortent soudainement de terre, dans les capitales, les campagnes, près des fronts et dans les zones épargnées, ils ne sont que des tombeaux vides, des successions de noms dans l’ordre alphabétique, qui rendent hommage au courage des soldats, mais aussi au sacrifice des milliers de veuves et d’orphelins. Trouver des causes percutantes, des superlatifs qui cristallisent en une victime la douleur d’un conflit mondial, c’est aussi apaiser des populations qui ont besoin de se recueillir.
C’est pourquoi Henry Gunther devient facilement l’emblème d’une jeunesse sacrifiée, parfois bêtement. Il évoque le fossé qui sépare chefs et soldats : les armées sont des outils qui font la mort, seuls les généraux font la guerre.
Le symbole de tous les symboles, celui qui touche sans énumérer la douleur, c’est évidemment le soldat inconnu, qui repose sous l’Arc de Triomphe (un monument érigé à la gloire de la guerre et des conquêtes…) depuis 1921. D’où vient-elle, cette tradition-là ?
Comme souvent en France, les meilleures idées nous viennent… des Anglais ! En effet, nos voisins d’outre-Manche décident d’inhumer un soldat inconnu dans la cathédrale de Westminster le 11 novembre 1920. Les Français endeuillés jalousent cette annonce forte, alors que le parlement instable propre à la IIIe république se dispute des détails, ici l’endroit, la date et les circonstances de cette sépulture symbolique, afin d’instrumentaliser un peu plus cet acte fort. La gauche la voudrait au Panthéon aux côtés des grands hommes qui se sont battus pour le progrès et les valeurs de la France, tandis que la droite réclame, pour rendre honneur à l’armée française dans son ensemble, l’Arc de Triomphe impérial. Débats, menaces et scandales médiatiques ralentissent comme d’habitude en France la prise de décision. Le 2 novembre 1920 et après deux mois de tribulations politiques, les ministres se réunissent en conseil extraordinaire et décident en vitesse que le poilu anonyme reposera sous le monument de l’Arc de Triomphe. Il ne reste que quelques jours pour exhumer un corps d’un cimetière dans les zones d’occurrence des huit combats les plus meurtriers : Artois, Champagne, Aisne, Flandre, Ile-de-France, Lorraine, Somme et Verdun. Tout cela se fait en secret, mais on apprendra plus tard que les généraux sommés de choisir les cadavres peinent à différencier les restes alliés des restes ennemis, tous éparpillés sur le sol meurtri des anciens champs de bataille.
C’est Auguste Thin qui se verra attribuer la tâche symbolique du choix d’un seul soldat, puisque le poilu Martiniquais rescapé de Verdun qui devait assumer cette mission meurt le matin de la cérémonie de la typhoïde ! Le soldat remplaçant est lui un rescapé du fameux régiment 132, décimé en Champagne. Face aux huit tombes, il additionne les chiffres aléatoires du régiment qui lui ont valu cette expérience terrible. Comme si ce hasard de son affectation devait décider quelque chose de plus grand. Un, trois et deux font six. C’est ainsi qu’il pointe du doigt la sixième tombe, celle de celui qui repose toujours sous l’Arc de Triomphe, bientôt cent ans après. Encore un coup du sort donc, de chiffres et de coïncidences dans la commémoration de cet emblème. La tombe ornée d’un drapeau français et d’une croix de guerre défile à temps sous l’Arc le 11 novembre, mais n’est inhumée qu’en janvier 1921, le temps de creuser une tombe dans les fondations solides du monument à l’époque centenaire. Sa flamme, celle du courage de l’armée française, est ravivée chaque soir à 18 h 30.
*
C’est peut-être un comble d’honorer la mort d’un soldat dont le nom restera connu dans l’histoire par la simple heure malheureuse de sa mort, tout en érigeant une tombe majestueuse pour celle d’un soldat dont la valeur est justement l’anonymat. Dans tous les cas, on comprend que les symboles sont des histoires que l’on raconte et qui perdurent, une mémoire qui borde aussi bien les routes de la Meuse que nos monuments impériaux.
Auteur : Léa Petitdemange