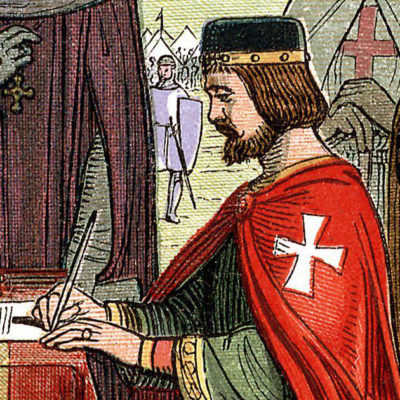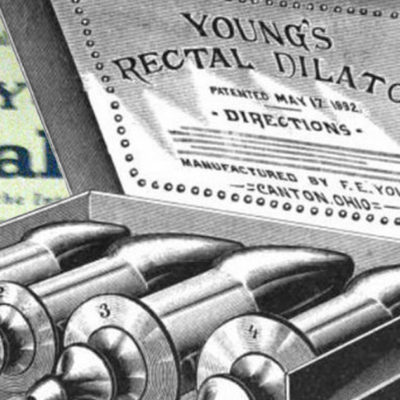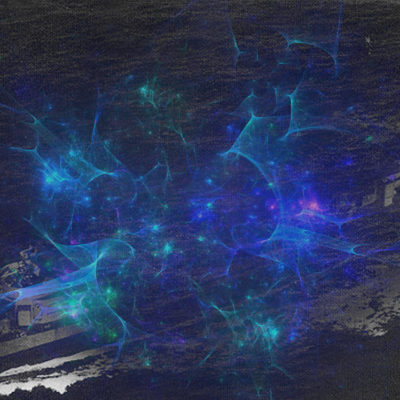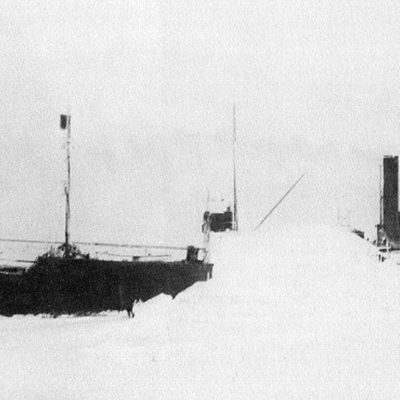« La Goulue aux bas de soie noire, son pied de satin noir dans la main, faisait virevolter les soixante mètres de dentelle de ses jupons, et montrait son pantalon cocassement brodé d’un coeur qui se tendait, farceur, sur son petit postérieur. Lorsqu’elle s’inclinait en des saluts irrespectueux, des touffes de choux de rubans roses aux genoux, une masse adorable de dentelles descendait jusqu’aux chevilles fines, laissant paraître et disparaître ses adorables jambes, agiles, spirituelles, aguicheuses. La danseuse décoiffait son cavalier d’un petit coup de pied chic dans le chapeau, et faisait le grand écart, le buste droit, la taille mince dans sa blouse de satin bleu ciel et sa jupe de satin noir, coupée en forme de parapluie, s’étalant en ses cinq mètres de largeur.
Et c’était magnifique ! La Goulue était jolie et canaillement spirituelle à regarder, blonde, la frange de cheveux coupée sur le front arrivant nette aux sourcils. Le chignon en casque sur le haut de la tête, commençait en une mèche durement tordue sur la nuque afin de ne pas tomber pendant les danses. De ses tempes, la classique rouflaquette descendait en frisettes sur les oreilles, et de Paris à New York, en passant par les bouges de Whitechapel de Londres, toutes les filles de l’époque voulurent cette même coiffure et le même ruban de couleur noué au cou ».

En quelques phrases, la Goulue est décrite, éclatante, au début des années 1890. Et par un témoin digne de foi, puisqu’il s’agit des propos d’Yvette Guilbert, célèbre chanteuse de caféconcert et actrice, qui fait alors son apprentissage de la scène au fameux Moulin-Rouge.
La Goulue est connue comme un phénomène indissociable de la Belle Époque. Bien sûr, comme toute légende qui se respecte, l’incertitude règne quant à la biographie de notre danseuse. De son vrai nom Louise-Joséphine Weber, elle est née à Clichy, près de Paris, en 1865 ou 1866, on le sait pas précisément. La seule chose dont nous pouvons être surs est qu’elle n’aurait sans doute été qu’une petite Alsacienne si les canons des Prussiens n’avaient pas obligé sa famille à s’exiler à Paris.
Son père, Dagobert Weber, est un charpentier alsacien, et sa mère, Hélène Courtade, blanchisseuse de son état. Un métier auquel n’aspire pas véritablement la môme Weber : elle raconte à qui veut l’entendre ses premières rencontres payantes à l’âge de quinze ans, dans les cabanes qui s’élevaient sur les fortifications du vieux Paris. Mais ses écarts de conduite sont pris en main. En effet, sa mère ayant quitté le foyer conjugal quelques années auparavant et son père étant mort suite à ses blessures de la guerre de 1870, son oncle la recueille et la fait enfermer dans une maison de correction.

Elle en sort quelque temps plus tard et découvre l’univers de la danse. Dévergondée, la môme Weber fréquente assidument les bals populaires. Ainsi, puisqu’elle est douée et, son joli minois aidant, elle fait ses débuts à seize ans au Bal Debray au Moulinde-la-Galette, guinguette renommée. Mais, en attendant le véritable succès, elle doit travailler pour survivre. Après un bref moment comme blanchisseuse, elle se rapproche du monde artistique. Elle devient alors un modèle pour les photographes et les peintres de Montmartre, notamment Auguste Renoir.
On ne sait pas avec précision d’où vient son surnom : soit de sa liaison avec un jeune diplomate dénommé Gaston Chilapane, mais surnommé « Goulu Chilapane », soit de son insolente habitude à vider les verres des clients qu’elle approchait lors de ses danses. Qu’importe : les deux anecdotes illustrent à la perfection le caractère vivace et gourmand de la pétillante Louise Weber.
Quand elle danse, elle possède un sens incomparable du rythme et un érotisme dans le mouvement qui fascine ceux qui la regardent. Elle est donc engagée à l’Elysée-Montmartre et au Jardin de Paris. Elle ne danse évidemment pas le menuet, mais bien le quadrille naturaliste. Cette nouvelle danse, rebaptisée en 1928 French Cancan, du mot boucan, par le directeur artistique du Bal Tabarin, Pierre Sandrini, commence à faire fureur.

Plus la France devient sensuelle … plus le prestige de la Goulue augmente. Ce pas érotique présente l’immense avantage de laisser entrevoir les dessous des danseuses, des pantalons qui sont fendus à l’endroit approprié. Quelques années plus tard cette coquine fente sera proscrite, du moins sur scène. Mais, en attendant cette interdiction, La Goulue fait profiter ses clients de cet interstice coquin. Accompagnée de son partenaire, le filiforme Valentin le Désossé, géant de deux mètres avec ses souliers vernis, ses pantalons collants et son chapeau haut-de-forme, elle danse le « chahut », autre nom du cancan. Son curieux acolyte, qui travaille le jour chez son frère notaire et se transforme le soir en danseur émérite, éclipse en cet art toutes ses copines aux pittoresques pseudonymes : Louisette, Fernande, Rayon d’Or, la Torpille, Nana, la Sauterelle, Grille d’Égout (il lui manquait une dent sur deux), Georgette la Vadrouille, Cri-Cri, Nini-Pattes-en-l’Air, Mélinite (alias Jane Avril), la Môme Fromage ou encore Demi Siphon (qui mourra en faisant le grand écart !). Ensemble, ils deviennent célèbres dans l’univers mondain parisien.
Quand Charles Zidler, impresario, ouvre en 1889 le Moulin-Rouge, il engage la Goulue et ses consoeurs chahuteuses pour en faire son attraction principale… et le succès est au rendez-vous. Un large public se presse au Moulin-Rouge pour voir la Goulue et sa bande lever la jambe. La jeune Weber devient la coqueluche du tout-Paris : elle est engagée à huit cents francs par mois et vit luxueusement.
Dans le même temps, la tumultueuse danseuse devient un des modèles favoris du peintre Toulouse-Lautrec. C’est donc naturellement qu’en 1891, celui qu’on appelle respectueusement « Monsieur Toulouse » conçoit la fameuse affiche qui rend la Goulue célèbre et qui assurera sa gloire posthume ainsi que celle de Valentin-le-Désossé. Fut-elle la maîtresse du peintre ? C’est probable. Ils se connaissaient depuis plusieurs années et Lautrec l’a suivie au Moulin-Rouge. De toute évidence, la Goulue collectionne les hommes, ce qui ne l’empêche pas, à l’occasion, d’afficher une bisexualité notoire avec la Môme Fromage, pour marquer son provisoire dégoût de la gent masculine. On raconte même qu’elle aime déambuler dans Montmartre avec un bouc tenu en laisse, sans doute pour donner une preuve de son excentricité et de son indépendance.

La Goulue gagne d’ailleurs richement sa vie, mais malgré les conseils de Zidler, elle mène grand train et dépense sans compter. Quand, après cinq ans de triomphe, le public se lasse de cette femme qui s’empâte un peu, elle s’obstine et refuse de renoncer. Toutefois, en 1895, le quadrille du Moulin-Rouge se disloque : si les autres danseuses abdiquent, la Goulue, possédée par le génie de la danse, ne se résigne pas et poursuit l’aventure. Sur les conseils de Valentin le Désossé, elle avait tout de même placé ses économies chez le frère de celui-ci, notaire à Sceaux. Elle achète donc une baraque à la Foire du Trône, où elle interprète, outre le cancan, la danse du ventre. À cette occasion, Lautrec exécute deux grands panneaux décoratifs destinés à en orner l’entrée. Les affaires prospèrent un temps mais, par malheur, le public finit par déserter de nouveau.
La Goulue, pleine de ressources et très imaginative, décide alors de monter sa propre ménagerie et de se faire dompteuse. Le goût de la chose lui est venu en 1898, quand, pour un numéro de gala, le dompteur Adrien Pezon l’a fait pénétrer dans la cage aux fauves. À l’ouverture de son nouveau commerce, elle s’associe avec Joseph-Nicholas Droxler, un prestidigitateur, et finit par l’épouser le 10 mai 1900. À ses côtés, et avec son fils, Simon Victor (né de père inconnu en 1895), elle danse le cancan dans la cage aux lions. Mais le couple tombe de Charybde en Scylla : des accidents avec les bêtes, des scènes de jalousies embrasées et la santé fragile de l’enfant auront raison de leur affaire.

En quelques années, les affaires périclitent tandis que s’amenuise la ménagerie. De plus, Doxler, dont elle s’était séparée, meurt pendant la Première Guerre mondiale. Son fils Simon meurt quelques années plus tard, en 1923, après une longue maladie qui épuise financièrement les dernières ressources de la Goulue. À vrai dire, on ne sait pas grand-chose des dernières années que vit l’ancienne chahuteuse, si ce n’est qu’à la suite de ses malheurs, elle sombre dans l’alcoolisme. Toutefois, nous avons découvert un précieux témoignage : ces lignes, rédigées par un inconnu, peut-être un journaliste, en 1925 :
Dans une baraque de foire ornée d’une banderole : « Ici la célèbre Goulue du Bal du Moulin-Rouge », un bonimenteur essaie d’attirer les curieux en racontant par bribes le passé de la danseuse. C’est une dérision. Le rideau dévoile une grosse femme en oripeaux usés, aux chairs trop abondantes, au sourire hideux. Cette femme que notre curiosité ne dérange même pas de son vice, sans tourner la tête, assise, dans un coin de l’estrade, sur une caisse de bois blanc, boit à même la bouteille un litre de gros rouge. Quand elle a fini, après avoir fait claquer sa langue de satisfaction, elle s’essuie la bouche du revers de la main et crache par terre en s’esclaffant … On essaie de la faire parler : « C’était le bon temps, hein, ma vieille, tu te souviens ? » Elle répète, la voix pâteuse, ponctuant de ricanements ses phrases : « Si je me souviens, tu parles ! Qu’est-ce qu’il y avait comme ménesses (prostituée qui est généralement la maîtresse du souteneur), et puis les « Youp et Youp », c’était marrant ! »
Impossible d’en tirer autre chose, on essaie mais en vain ! Un tableau guère reluisant ! À part ces piges foraines, on prête à la Goulue, en fin de vie, nombre d’emplois aussi divers que provisoires : servante dans un bordel, bouquetière, marchande de bonbons à l’entrée du Moulin-Rouge. Bref, c’est la misère et l’alcoolisme.
Au début de l’année 1929, elle habite du côté de la rue des Rosiers à Saint-Ouen, avec un petit chien du nom de Rigolo et un minuscule morceau de dentelle poussiéreux, dernier souvenir de ses affriolants dessous. Cette année est aussi celle de la mort de la Goulue et de l’achat par les Musées nationaux des décorations que Lautrec avait exécutées pour elle trentecinq ans auparavant. La reine des chahuteuses s’éteint le 29 janvier 1929, à l’hôpital Lariboisière, « misérablement » diront les journaux qui consacreront un entrefilet à son décès, accompagné de la photographie d’une vieille femme usée et bouffie.